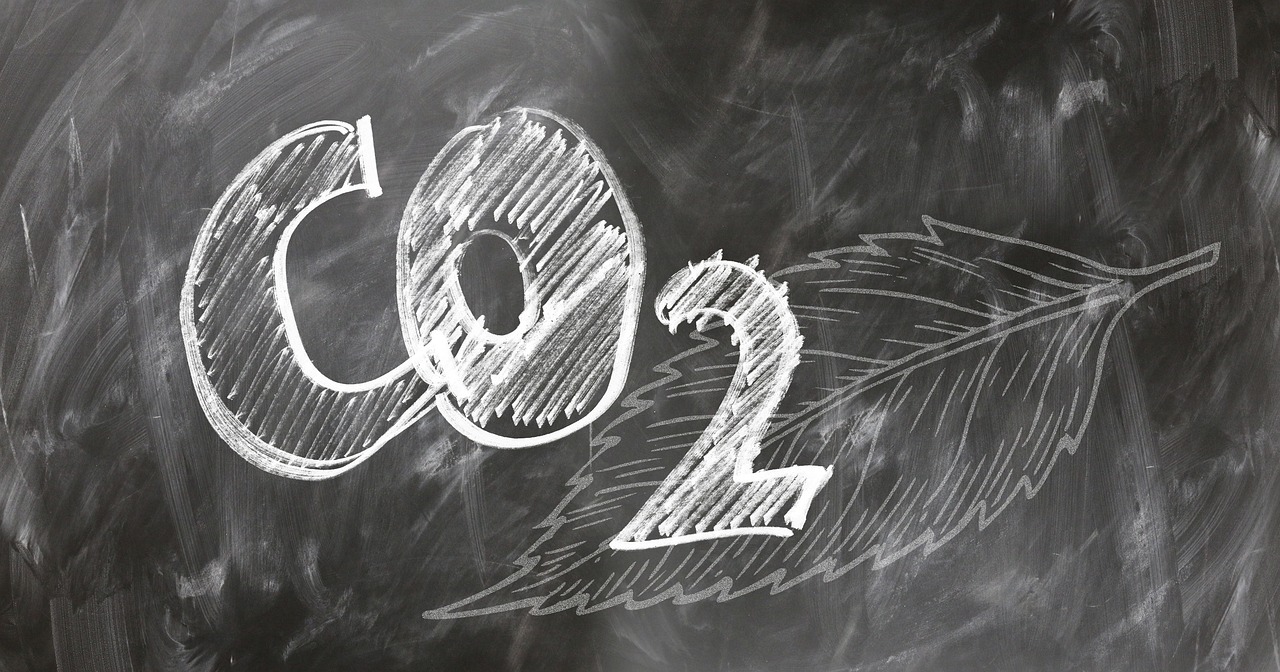|
EN BREF
|
L’aviation, souvent perçue comme un moyen de transport presque anodin face au changement climatique, est en réalité un contributeur important aux émissions de gaz à effet de serre. Ce texte explore les nombreuses idées reçues entourant l’impact environnemental de ce secteur. En fournissant des données chiffrées et des études scientifiques, il révèle l’importance des effets hors CO2, tels que les trainées de condensation, qui aggravent le réchauffement climatique. De plus, il aborde les futures solutions pour réduire l’empreinte écologique de l’aviation, y compris l’utilisation de carburants alternatifs et des innovations technologiques, tout en soulevant des questions cruciales sur la croissance durable de ce secteur. À travers une approche informative, ce document se donne pour mission de clarifier les enjeux liés à l’aviation et au climat.
Dans un monde où l’aviation est devenue un symbole de modernité et de liberté, elle est également au cœur des préoccupations environnementales. Cet article a pour but de déconstruire les idées reçues sur l’impact de l’aviation sur le changement climatique. En examinant les données scientifiques et en clarifiant les effets réels des émissions de gaz à effet de serre, nous viserons à offrir une conversation éclairée sur ce sujet complexe.
Liens entre aviation et changement climatique
L’impact de l’aviation sur le climat n’est-il pas anecdotique ?
Il est souvent avancé que l’aviation représente une part négligeable des émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, les chiffres sont révélateurs : en 2018, les vols commerciaux étaient responsables de 2,6 % des émissions mondiales de GES et de 5,1 % du réchauffement climatique résultant d’activités humaines entre 2000 et 2018. Le kérosène brûlé en un an équivaut à environ 1 milliard de tonnes de CO2, ce qui dépasse les émissions de pays entiers comme le Japon.
À une échelle individuelle, prendre un vol aller-retour de Paris à New York génère environ 1,7 tCO2e, correspondant à 20 % des émissions annuelles d’un·e français·e. Avec une croissance projetée d’environ 3 % par an pour l’aviation, son rôle dans les émissions mondiales va sans aucun doute croître, attirant notre attention sur la nécessité de réduire cette empreinte.
Les effets « hors CO2 » de l’avion sont trop incertains pour être comptés…
Une incompréhension fréquente entoure les impacts « hors CO2 » des vols aériens. En effet, au-delà des émissions de CO2, l’aviation génère d’autres effets sur le climat à travers des processus physico-chimique. Les trainées de condensation laissées par les avions, visibles dans le ciel, se transforment parfois en nuages cirrus qui ont un effet réchauffant sur le climat. Bien que l’ampleur de cet effet soit difficile à quantifier, des études suggèrent que leur impact pourrait être deux à trois fois supérieur à celui du CO2 émis lors de la combustion des carburants.
En d’autres termes, la négligence de ces effets pourrait nous faire sous-estimer de manière significative l’impact réel de l’aviation sur le climat. Des efforts doivent être faits pour mieux comprendre et intégrer ces effets hors CO2 dans les modèles climatiques actuels.
Et le fret aérien dans tout ça ?
Un autre aspect souvent négligé est le fret aérien. En 2020, il représentait moins de 0,5 % des marchandises transportées en Europe mais était responsable de 10 % des émissions associées au transport de marchandises. Les avions émettent en moyenne 25 fois plus de CO2 que les camions sur de longues distances et plus de 100 fois plus que le transport par train ou par bateau.
Avec l’essor du e-commerce, le fret aérien a connu une croissance rapide et pourrait entraîner une augmentation des émissions. Bien que 70 % de la capacité de fret soit transportée dans les soutes d’avions passagers, il est prévu que cette part diminue alors que l’industrie s’oriente vers plus d’avions cargos, ce qui pourrait accroître l’impact climatique du fret aérien.
L’aviation doit-elle redouter les impacts physiques du changement climatique ?
Il existe une perception erronée du fait que l’aviation est peu affectée par les impacts physiques du changement climatique. Pourtant, de nombreux aéroports sont situés dans des zones côtières à faible altitude, particulièrement vulnérables à l’élévation du niveau de la mer. Actuellement, 269 aéroports sont à risque à cause de la submersion d’ici 2100, avec des projections suggérant une augmentation de 30 % dans un scénario de réchauffement limité à 2°C.
Les aléas climatiques tels que >la chaleur extrême peuvent également perturber les opérations aériennes, comme le montre la vague de chaleur de 2017 qui a bloqué plus de 50 avions à Phoenix. La vulnérabilité de l’aviation face à ces changements doit être intégrée dans les plans de sécurité et d’infrastructure des compagnies aériennes.
Les différents leviers disponibles pour décarboner le secteur
L’aviation n’a-t-elle pas déjà réduit sa consommation par 2 depuis 1990 ?
Il est vrai que des progrès significatifs ont été réalisés pour diminuer l’intensité des émissions de l’aviation. Grâce aux nouvelles générations d’avions et à des initiatives d’éco-pilotage, la consommation de carburant par passager-kilomètre a été divisée par plus de deux entre 1990 et 2018. Cependant, il est crucial de discernement entre émissions en intensité et émissions en absolu. Bien que les émissions par passager aient diminué, le trafic global a augmenté de 4,6 fois, ce qui a entraîné un doublement des émissions totales.
Cet effet rebond se produit car des économies de carburant rendent le vol moins cher et incitent ainsi une augmentation des vols, exacerbant le problème des émissions globales.
L’aviation a déjà son outil de lutte contre le changement climatique !
Le dispositif CORSIA, créé pour compenser toutes les émissions supplémentaires de CO2 au-delà d’un niveau de référence, est souvent présenté comme une solution pérenne. Cependant, ce mécanisme, qui a été adopté par l’OACI, est critiqué pour sa relative légèreté. Actuellement, il ne s’applique qu’à 60 % du trafic international, proposant des exclusions pour certains pays et emplacements.
Ce système oblige les compagnies à acheter des « offsets » sur les marchés volontaires du carbone pour compenser leurs émissions. Toutefois, il ne s’attaque pas à la racine du problème, laissant des questions cruciales sur l’intégrité des crédits carbone souvent non résolues. De plus, le renforcement des contrôles pour limiter les émissions est d’une importance capitale, ce qui n’est pas encore suffisant dans le cadre de CORSIA.
L’avion à hydrogène ou électrique va-t-il permettre de décarboner l’aviation d’ici à 2050 ?
Les technologies de l’hydrogène et des avions électriques apportent un nouvel espoir pour la décarbonation. En théorie, les avions fonctionnant à l’hydrogène pourrait réduire leur empreinte carbone de jusqu’à 65% si toutes les étapes de leur production et utilisation sont considérées. Cependant, cela reste à un stade très spéculatif car plusieurs technologies essentielles sont encore en développement.
Dans le cas de l’hydrogène, bien qu’il ait une densité énergétique élevée, son volume est considérablement plus important que celui des combustibles fossiles, ce qui pose des défis logistiques et de sécurité. Par ailleurs, des délais de mise en œuvre jusqu’à 2035 pour des modèles appropriés limitent leur potentiel d’impact à court terme sur la présente flotte aéroportuaire.
Va-t-on pouvoir continuer à voler autant grâce aux carburants alternatifs (dits “SAF”) ?
Les carburants alternatifs ont suscité un grand intérêt, représentant une potentielle réduction des émissions de CO2 par rapport aux carburants fossiles. Cependant, bien que ces biocarburants puissent réduire l’impact des vols, leur utilisation reste limitée. En 2018, leur part dans le mélange de carburants a été à peine de 0,01 %, ce qui souligne l’accès restreint à ces matières premières.
De plus, leur production exige des ressources limitées, soulevant des questions éthiques et environnementales sur la compétition avec d’autres usages, tels que l’agriculture ou l’énergie. Par conséquent, bien que les SAF soient un levier envisageable, ils ne suffiront pas à compenser l’augmentation continue du trafic aérien.
Développement durable et justice sociale
Un mode de transport pour l’élite ?
Au niveau mondial, l’aviation demeure un privilège. Moins de 1% de la population génère plus de 50% des émissions liées aux vols commerciaux, et 80% de la population mondiale n’a jamais pris l’avion. En France, les statistiques révèlent que 33% des Français n’ont jamais voyagé en avion, un chiffre qui varie considérablement selon le revenu, avec une proportion plus élevée parmi ceux ayant des revenus inférieurs.
La situation ne se limite pas à l’accès à l’aviation commerciale; des modes de transport alternatifs tels que les TGV sont également plus accessibles aux classes supérieures. Cela soulève des préoccupations éthiques sur l’accès équitable aux transport aérien et met en lumière les contrastes entre les modes de transport en termes d’émergence des émissions.
Quelles pistes pour un accès économiquement équitable au transport aérien ?
Pour aborder la question d’un accès équitable, plusieurs stratégies peuvent être envisagées. L’une des plus intéressantes est la Frequent Flyer Tax, une forme de taxation progressive appliquée aux vols aériens, visant à imposer davantage ceux qui voyagent fréquemment par avion. Cela pourrait inciter une réduction des voyages aériens parmi les plus riches tout en offrant un accès plus juste aux moins fortunés.
Une autre approche pourrait être l’introduction de quotas, qui limiteraient le nombre de kilomètres que chaque citoyen pourrait parcourir par avion. Cette mesure garantirait que tout le monde ait une part égale du « budget carbone » de l’aviation, réduisant ainsi les inégalités d’accès liées au transport aérien.
Les jets privés : un impact réel ou un symbole ?
La question des jets privés suscite une attention particulière. Bien que leur impact au niveau des émissions soit considérable, leurs contributions totales aux émissions du secteur sont moins significatives (environ 2%). Cela dit, leur utilisation soulève un débat moral sur la justice sociale dans le contexte d’une crise climatique croissante.
Réguler ce secteur pourrait être crucial dans le cadre d’un effort plus large pour faire face aux enjeux climatiques, mais cela nécessitera des discussions politiques et sociales sur la nécessité de bien identifier les solutions.
Actions individuelles et collectives
On peut continuer à voler en compensant ?
Si l’achat de crédits carbone peut sembler une méthode facile pour compenser les émissions de vols aériens, il est important de comprendre que cela ne réduit pas directement l’empreinte carbone d’un voyage. Les actions de compensation doivent être séparées du choix de prendre l’avion, faisant de la réduction des voyages un impératif plus significatif pour la durabilité.
En fin de compte, la manière la plus efficace d’accélérer le net zéro serait de réduire le trafic aérien plutôt que de se fier uniquement à des compensations souvent non vérifiables.
Est-ce qu’il vaut mieux voyager en avion ou en voiture, même seul ?
Une question récurrente est celle de la comparaison entre les vols et les voyages en voiture. Bien que l’on puisse penser que l’avion est moins émetteur par rapport à une seule personne dans une voiture, les émissions de GES, incluant les effets hors CO2, révèlent que l’avion génère 260 gCO2e/passager.km comparé à 196 gCO2e/passager.km pour une voiture avec un seul passager.
Les alternatives comme le train ou le bus sont souvent négligées, alors qu’elles émettent généralement moins de CO2 par passager. C’est là qu’intervient un changement de mentalité nécessaire pour encourager des modes de transport plus durables.
Est-ce qu’il vaut mieux voyager en classe éco qu’en business ?
Les différences d’empreinte carbone entre les classes économiques et affaires sont notables. Les émissions par passager en classe affaires sont environ trois fois supérieures à celles des voyageurs en classe économique. Ainsi, opter pour un vol en classe économique permet de réduire significativement l’empreinte carbone d’un voyage sans nécessairement sacrifier la qualité de l’expérience.
Les compagnies aériennes à bas coût misent sur une approche maximum à la rentabilité, ce qui peut paradoxalement diminuer l’impact environnemental des émissions par passager tout en favorisant une augmentation globale du trafic.
Est-ce que l’achat de SAF (Sustainable Aviation Fuel) avec son billet est une bonne idée ?
Acheter des SAF peut réellement réduire l’empreinte carbone d’un vol, contrairement à la compensation carbone. Néanmoins, la disponibilité de ces biocarburants reste extrêmement limitée, et l’utilisation globale de SAF au niveau de l’aviation est encore marginale en comparaison du kérosène classique.
Les grands progrès dans la production et l’intégration des SAF dans les systèmes aéroportuaires sont essentiels pour atteindre des niveaux significatifs d’impact. C’est un levier important, mais ne suffira pas à compenser le besoin de réduire le nombre de vols.
Quel rôle pour les entreprises ?
Les déplacements professionnels constituent un segment crucial des émissions du secteur aérien, avec environ 30% du total des déplacements en Europe. Les entreprises se doivent de jouer leur part dans cette transition. Cela inclut minimiser les voyages aériens en favorisant des alternatives comme le train pour les trajets courts.
Les entreprises doivent également procéder à des débriefings sur les pratiques et sensibiliser leurs salariés à l’importance de réduire leurs émissions de transport. Des politiques de voyage rigoureuses, associées à des données sur les émissions, sont des entreprises essentielles à mettre en œuvre pour contribuer à la réduction des émissions du secteur aérien.
Conclusion et appel à l’action
Il est donc impératif d’agir à tous les niveaux pour réduire l’empreinte carbone de l’aviation. L’éducation, la sensibilisation et une politique proactive sont nécessaires pour transformer ce secteur face aux enjeux climatiques. Le changement ne pourra se réaliser qu’avec un engagement collectif pour une aviation plus durable.

L’aviation est souvent perçue comme un secteur à la pointe du progrès technologique, promettant des vols plus sûrs et moins polluants. Pourtant, derrière cette image se cachent des réalités bien plus complexes. Les études montrent que l’aviation commerciale représente environ 2,6 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à 5,1 % du réchauffement climatique entre 2000 et 2018. Cela souligne l’importance d’une réflexion critique sur l’impact environnemental de ce mode de transport.
Un aspect souvent minimisé est l’effet des émissions « hors CO2 ». Beaucoup croient à tort que seules les émissions de dioxyde de carbone comptent. En réalité, les trainées de condensation produites par les avions ont un impact non négligeable en réchauffant la planète. Ces nuages artificiels, formés dans certaines conditions atmosphériques, contribuent à piéger la chaleur, ce qui complexifie encore davantage la question des émissions aériennes.
Les voyages en avion sont souvent justifiés par une croissance du trafic passagers. Cependant, cette croissance continue entraîne une augmentation des émissions, même si la consommation par passager a été réduite grâce à des innovations technologiques. Le phénomène d’effet rebond montre que l’augmentation de l’efficacité énergétique des avions peut paradoxalement conduire à une hausse des émissions globales, car un vol abordable incite à voyager davantage.
Le secteur du fret aérien mérite également une attention particulière. Bien qu’il ne représente qu’une petite fraction des transports de marchandises, son empreinte carbone est étonnamment élevée. En 2020, les avions de fret émettaient plus de 10 % des émissions associées au transport de marchandises, malgré le fait qu’ils ne transportent que 0,5 % des biens en Europe. Cela souligne la nécessité d’envisager des alternatives moins polluantes, comme le rail ou la route.
Enfin, il est crucial d’évaluer l’impact des carburants alternatifs, souvent présentés comme une solution miracle. Bien qu’ils puissent réduire les émissions de CO2, leur production pose des défis considérables concernant leur disponibilité et leur coût. De plus, l’utilisation de ces carburants ne remplace pas les effets « hors CO2 » liés au fonctionnement des avions, ce qui rend leur adoption insuffisante pour atteindre les objectifs climatiques fixés.